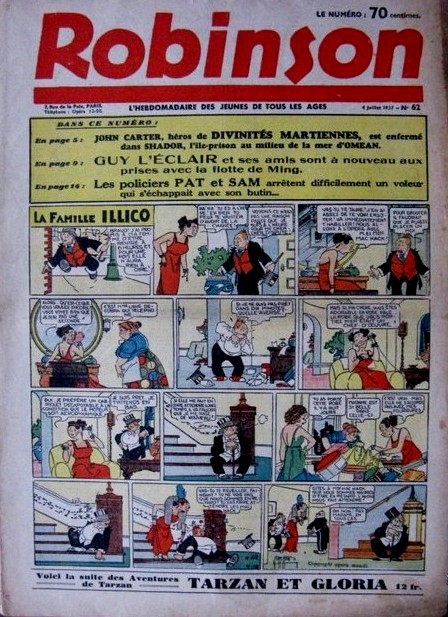(Satellite n°18 - juin 1959)
(Satellite n°18 - juin 1959)
LES LUNES DE MARS sont (peut-être) des satellites artificiels
 On ne sait pas grand chose des satellites de la planète Mars,
sinon que
ce sont les deux plus petites « lunes » du système solaire, et
que leur
comportement est plutôt bizarre. Un savant russe, le professeur
L.
Schlowski, spécialiste connu de la radio-astronomie, a récemment
fait,
à ce sujet, une troublante communication à l'Académie des Sciences
de
Moscou.
On ne sait pas grand chose des satellites de la planète Mars,
sinon que
ce sont les deux plus petites « lunes » du système solaire, et
que leur
comportement est plutôt bizarre. Un savant russe, le professeur
L.
Schlowski, spécialiste connu de la radio-astronomie, a récemment
fait,
à ce sujet, une troublante communication à l'Académie des Sciences
de
Moscou.
- L'orbite de Phobos (la plus grosse des deux lunes martiennes
et la
plus proche de la planète) a basculé, dit-il, de 2 degrés 1/2
en moins
d'un siècle.
Et il a ajouté : « Le fait est anormal. Pour qu'il puisse être
expliqué
mathématiquement, il faudrait que Phobos soit un corps creux.
Or, on ne
connaît pas de corps creux dans la nature. »
De là, à soutenir l'hypothèse que les lunes de Mars puissent
être «
artificielles », il n'y a qu'un pas...
 Les lunes de Mars... Ceux qui lisaient « Robinson », il y a vingt
ans,
en ont bien souvent rêvé. Sous les deux lunes de la diaphane
nuit
martienne, l'une se ruant vers l'autre presque immobile dans
le ciel,
John Carter, « Le Conquérant de la Planète Mars » (1) galopait
des huit
pattes d'un formidable « tarout » (thoat dans le texte américain),
à
travers la mousse jaunâtre des fonds d'océan desséchés, volant
au
secours de la belle Dejah Thoris, l'incomparable Princesse de
Mars
(Barsoom en martien)...
Les lunes de Mars... Ceux qui lisaient « Robinson », il y a vingt
ans,
en ont bien souvent rêvé. Sous les deux lunes de la diaphane
nuit
martienne, l'une se ruant vers l'autre presque immobile dans
le ciel,
John Carter, « Le Conquérant de la Planète Mars » (1) galopait
des huit
pattes d'un formidable « tarout » (thoat dans le texte américain),
à
travers la mousse jaunâtre des fonds d'océan desséchés, volant
au
secours de la belle Dejah Thoris, l'incomparable Princesse de
Mars
(Barsoom en martien)...
C'est d'ailleurs dans un roman que furent « découvertes » les
deux
lunes de Mars. Dans «Les Voyages de Gulliver » (parus en 1726),
l'écrivain irlandais Jonathan Swift les fait décrire -- avec
la plus
étonnante des intuitions - par les astronomes de la ville volante
(soutenue par « antigravatation » !) de Laputa.
En fait, cependant, ce n'est qu'un siècle et demi plus tard,
en 1877,
que l'astronome Asaph Hall, de l'Observatoire de Washington,
les
découvrit réellement. Bien d'autres que lui les avaient cherchées
avec
des instruments aussi et même plus puissants que le sien, et
n'avaient
rien vu. Luimême aurait abandonné leur recherche, si sa femme
ne
l'avait poussé à persister.
- "Elles n'étaient pas là hier" s'écria-t-il, littéralement effrayé.
Et quand il eut vérifié qu'elles étaient bien là, il leur donna
deux
noms impressionnants : Phobos (la Terreur) et Deimos (la Crainte)
tirés
de l'Iliade d'Homère. Elles avaient échappé aux observations
antérieures du fait de leur petitesse.
Phobos, a 12 km de diamètre - la longueur de Paris d'Ouest en
Est.
Deimos, 9 km de diamètre seulement - la largeur de Paris du Nord
au Sud
(2).
La première tourne à 6 000 km à peine de la surface martienne
et - plus
un satellite est proche d'une planète plus il va vite - elle
effectue
sa révolution autour de Mars en 7 h 39 mn 13 s 85/100. La seconde,
à 20
000 km de distance de la planète, se contente d'en faire le tour
en 30
h 17 mn 54 s 9/10.
On n'en sait guère plus sur ces deux minuscules lunes. Mais ces
indications sont déjà suffisamment extraordinaires.
UN COMPORTEMENT BIZARRE
 Mars tourne sur son axe à peu près dans le même temps que la
Terre.
Exactement en 24 h 37 mn 22 s 62/100 . Phobos fait donc trois
fois le
tour de la planète, pendant que celle-ci ne fait qu'un tour sur
ellemême. Du fait de cette rapidité, cette lune a un mouvement
apparent
â contre sens des autres astres. Cas unique dans le système solaire,
elle se lève à l'ouest (du côté où le soleil se couche) et se
couche à
l'est. Elle ne reste à chaque passage que 4 h 30 dans le ciel,
si bien
que, dans l'espace d'un jour martien, pour un observateur placé
sur la
planète, cette curieuse lune montre à ses passagers, toute une
série de
phases variées, devenant pleine, deux fois nouvelle et deux autres
fois
pleine, par exemple.
Mars tourne sur son axe à peu près dans le même temps que la
Terre.
Exactement en 24 h 37 mn 22 s 62/100 . Phobos fait donc trois
fois le
tour de la planète, pendant que celle-ci ne fait qu'un tour sur
ellemême. Du fait de cette rapidité, cette lune a un mouvement
apparent
â contre sens des autres astres. Cas unique dans le système solaire,
elle se lève à l'ouest (du côté où le soleil se couche) et se
couche à
l'est. Elle ne reste à chaque passage que 4 h 30 dans le ciel,
si bien
que, dans l'espace d'un jour martien, pour un observateur placé
sur la
planète, cette curieuse lune montre à ses passagers, toute une
série de
phases variées, devenant pleine, deux fois nouvelle et deux autres
fois
pleine, par exemple.
Deimos n'est pas moins insolite. Certes, cette seconde lune se
lève
correctement à l'est et se couche à l'ouest, mais sa révolution
autour
de la planète suit, à moins de six heures d'écart, la rotation
de
celle-ci sur son axe, de telle façon que le mouvement apparent
de
Deimos, vu de Mars, est très lent. Son passage d'un horizon à
l'autre
demande 132 heures, ce qui correspond à plus de 4 révolutions
de Deimos
autour de la planète, et l'observateur placé sur le sol martien
verrait
ainsi une lune déroulant quatre fois toutes ses phases au cours
d'un
seul passage.
On comprend facilement qu'avec deux pareilles lunes dans leur
ciel, les
éclipses ne soient pas rares pour les Martiens - s'il y en a.
Nous,
Terriens, n'avons que 2 à 5 éclipses au plus, de soleil par an.
Sur
Mars, on en compte plus de 1 500 ! Phobos, à elle seule, passe
1 400
fois devant le soleil. Mais chaque éclipse ne dure que 19 secondes,
et
n'est jamais totale. Phobos n'occultant au maximum que le quart
du
disque solaire.
Deimos passe pour sa part 130 fois devant le soleil, plus longuement
(109 secondes) mais ne l'éclipse qu'encore moins (1/9°). Il est
vrai qu'il peut arriver parfois, rarement, que les deux lunes passent
ensemble devant le disque solaire. Et il se produit aussi de nombreuses
éclipses d'une lune par l'autre, ou de l'une ou l'autre, ou les
deux à la fois par l'ombre de la planète.
Leur spectacle contemplé
de la surface de la planète est des plus divers, de jour, comme
de nuit. Et ces nuits martiennes, piquées d'innombrables étoiles,
doivent être merveilleuses. Les constellations sont à peu près les
mêmes que vues de la Terre, mais l'étoile polaire de Mars, par suite
de l'inclinaison différente de cette planète sur son axe (25'% au
lieu de 23` 26) est la belle étoile Deneb (3). La Terre et Vénus
sont les étoiles du matin et du soir. Jupiter brille d'un bel éclat
dans le Capricorne. Phobos passe, quatre fois plus petit que notre
Lune malgré sa relative proximité et Deimos n'est qu'une étoile
parmi les autres. Tous deux luisent d'un éclat (albedo) argenté
bleuâtre qui pourrait être qualifié de « métallique » - comparé
à celui du fer par exemple.
CRITIQUE DES « INGENIEURS » MARTIENS
Et
ce n'est pas la première fois qu'on émet l'idée que les deux petites
lunes martiennes puissent être des «satellites artificiels». Cette
supposition a été utilisée à maintes reprises dans des romans de
science-fiction. Depuis Schiaparelli et ses « canaux » (à la même
époque, que la découverte de Phobos et- Deimos, 1877) bien d'autres
fabuleux exploits techniques ont été généreusement attribués aux
hypothétiques- ingénieurs martiens.
Phobos et Deimos sont trop
petits et trop loin pour que nos télescopes permettent d'affirmer
ou d'infirmer quoique ce soit. Mais les spécialistes ne se sont
pas privés d'émettre diverses objections, les unes de principe (ordre
de grandeur des énergies nécessaires), l'autre d'ordre pratique
(position des satellites). Von
Braun estime, en effet, que la meilleure position utile d'un satellite
« station dans l'espace », destiné à l'observation de la planète,
doit être telle
Von
Braun estime, en effet, que la meilleure position utile d'un satellite
« station dans l'espace », destiné à l'observation de la planète,
doit être telle
1° qu'il soit éloigné de moins du quart du diamètre
de celle-ci, de: manière que, vue du satellite, elle' occupe environ
130° de l'horizon céleste.
2° que la révolution du satellite
corresponde à une « fraction exacte » de la rotation de la planète.
C'est
pour ces raisons qu'il préconisait pour un tel satellite artificiel
de la Terre, l'orbite de 2 heures (1/12' de la rotation terrestre),
située vers 1 750 km d'altitude (nettement au dessous du 1/4 du
diamètre du globe, qui est de 3 200 km). Une autre orbite intéressante
est celle de 24 heures (autrement dit égale à la rotation de la
planète) sur laquelle, le satellite dans sa révolution reste stationnaire
au-dessus d'un point de la planète (dite orbite geostationaire
de Clarke).
Si l'on admet ces considérations, il faut avouer que les orbites
sur lesquelles sont placées Phobos et Deimos . sont aussi peu «
idéales »- que possible. Phobos est beaucoup trop loin (6000 km
alors qu'il devrait être à 1 700 km environ, 1/4 du diamètre, de
Mars) et Deimos est trop loin aussi pour que sa révolution
soit égale à la rotation de la planète. Bref, les fameux ingénieurs
martiens ne sont vraiment pas si forts_ que ça!
Bien sûr, Phobos,
tel quel, est néanmoins un excellent observatoire de Mars. Vue de
ce satellite, la planète apparaîtrait 82 fois plus grosse que notre
Lune, emplissant près de la moitié de la distance entre l'horizon
et le zénith, et elle semblerait tourner sur elle-même, en 11 h
6 mn d'Est en Ouest, en sens inverse de son mouvement réel de rotation
!
PLUS A NOTRE PORTÉE QUE LA LUNE?
En
tout cas, pour nous, Terriens, à la veille de la navigation interplanétaire,
les lunes de Mars, présentent un immense intérêt. Le Dr Jan Schilt,
astronome de l'Université Columbia, de New York, n'a pas hésité
à déclarer
-- Du point de vue pratique, les difficultés techniques
pour atteindre l'une des lunes de Mars, pourraient être plus aisément
résolues que celles soulevées pour atteindre notre propre Lune.
Le voyage jusqu'aux environs de Mars, à une soixantaine de millions
de km de la Terre, n'exigerait guère plus de combustible qu'une
approche de la Lune. Les lunes de Mars, comme la nôtre, n'ont pas
d'air mais l'attraction de leur gravité est extrêmement faible.
Une fois atteinte une orbite autour de Mars, les astronautes pourraient
se poser ou repartir à volonté de l'une de ces deux lunes. Peut-être,
concluait-il, le voyage aux lunes de Mars pourra-t-il être accompli
avant le voyage jusqu'à notre Lune !...
On saura alors si les
petits satellites de Mars sont « artificiels » ou non.

En attendant,
le professeur Schlowski soutient son opinion.
- Les astéroïdes
sont nombreux, dit-il, à proximité relative de Mars. Il suffirait
d'une accélération de 0,2g seulement pour qu'il soit très possible
d'en amener un sur une orbite autour de la planète, et ensuite de
l'évider - ce qui en ferait un « corps creux » - pour le transformer
en station-observatoire dans l'espace...
© Georges H. GALLET (SATELLITE N° 18 - juin 1959)
(1) Ce roman très célèbre de l'Américain Edgar Rice Burroughs, s'intitulait d'ailleurs Under The Moons of Mars (Sous les Lunes de Mars), à sa première parution en feuilleton dans le All-Story Magazine (février-juillet 1912), sous la signature « Norman Bean » qui résultait d'une coquille. L'auteur avait en réalité curieusement signé . « Normal Bean », ce qui se prononce, à peu prés, comme « Normal Being » - un « être normal », en anglais. On peut penser qu'il hésitait à ce sujet, du moins à ce moment, car après que son roman eut été repris par le grand quotidien New York Evening-World, il fut publié en volume, par l'éditeur McClurg de Chicago (1917), sous le titre A Princess of Mars (Une Princesse de Mars) dûment signé, cette fois, du vrai nom de son auteur. Il avait déjà enthousiasmé toute une génération de lecteurs de langue anglaise avant d'être traduit en français et publié dans Robinson (7 mars 1937-16 mai 1937), immédiatement suivi de « Divinités Martiennes » - The Gods of Mars (de 1918) - jusqu'au 15 août 1937. D'autres romans de Burroughs furent publiés dans Robinson jusqu'en 1940.
(2) Cf Pierre ROUSSEAU, Mars, terre mystérieuse, Hachette, éd.
(3) Alpha du Cygne, alors que notre polaire est Alpha de la petite Ourse.
Accueil I CineMars I CineListe I Plan du Site